Auditeurs:
Meilleurs auditeurs :
-
 play_arrow
play_arrow
Cadence Radio C'est différent, c'est vibrant !

Le réalisateur mexicain a présenté Mercredi au Festival Lumière de Lyon son adaptation tant attendue du chef-d’œuvre de Mary Shelley, un projet personnel qui résonne avec une urgence particulière à notre époque.
Guillermo del Toro ne cache pas son émotion lorsqu’il évoque Frankenstein. Pour le maestro du cinéma fantastique, cette adaptation n’est pas un simple film de plus dans une filmographie déjà impressionnante, mais l’aboutissement d’une passion qui a façonné toute sa carrière artistique.
Une révélation d’enfance
L’histoire d’amour entre del Toro et la créature de Mary Shelley remonte à ses sept ans, lorsqu’il découvrit le film de James Whale de 1931 avec Boris Karloff. Une expérience qui suivait curieusement une visite à la messe. Avec l’humour qui le caractérise, le réalisateur confie que c’est à ce moment précis qu’il comprit la religion, l’extase et la résurrection. Sa conclusion ? Sa grand-mère avait Jésus, lui avait trouvé son messie en Boris Karloff.
Quatre années plus tard, à onze ans, il découvre le roman original de Mary Shelley dans sa version de 1818, la plus brute et la moins édulcorée. Tandis que ses camarades rêvaient de stars hollywoodiennes, le jeune Guillermo se passionnait pour les sœurs Brontë et Mary Shelley.
Le bon moment pour raconter cette histoire
Devant une salle comble du Festival Lumière de Lyon, del Toro explique pourquoi il a attendu six décennies avant de concrétiser ce projet. L’adaptation de Frankenstein nécessitait le poids des années, la perspective d’un père plutôt que celle d’un fils. Le réalisateur se compare à Johnny Cash interprétant « Hurt » : certaines histoires exigent qu’on ait vécu, souffert, perdu pour être racontées avec authenticité.
Son interprétation du roman explore la paternité et la transmission des péchés entre générations, des thèmes qui résonnent différemment à soixante-et-un ans qu’à vingt.
Une question d’humanité plus actuelle que jamais
Pour del Toro, le roman de Mary Shelley pose une question fondamentale qui traverse les siècles : qu’est-ce qu’être humain ? Sa réponse est limpide : l’humanité réside dans la capacité à demander pardon et à pardonner.
Le cinéaste n’hésite pas à établir des parallèles avec notre époque. Ses propos sur l’intelligence artificielle et l’art ont déclenché un tonnerre d’applaudissements à Lyon. Dans une société qui banalise l’émotion et suggère que l’art peut être généré par des applications, del Toro voit un danger imminent. Pour lui, priver les gens d’art et d’émotion mène tout droit vers l’esthétique du fascisme.
Un film fait par des humains pour des humains
Le réalisateur insiste sur l’approche artisanale de son Frankenstein. Tous les décors sont réels, construits à taille humaine, agrémentés de miniatures créées méticuleusement. C’est un opéra cinématographique entièrement façonné par des mains humaines, un manifeste artistique qui affirme que l’art n’est pas seulement nécessaire, mais urgent.
Sa déclaration enflammée contre l’intelligence artificielle a trouvé un écho particulier auprès du public lyonnais, qui a ovationné le cinéaste lorsqu’il a lancé son célèbre « Viva México, Cabrones ! » avant de quitter la scène.
Une tragédie gothique, pas un film d’horreur
Del Toro a toujours envisagé son Frankenstein comme une tragédie plutôt qu’un film d’horreur, une vision qui transparaît dans chaque plan de ces 149 minutes. La magnificence gothique du film rappelle le Dracula de Francis Ford Coppola, tant par ses décors somptueux que par son atmosphère envoûtante et ses costumes d’époque.
Le récit débute près du pôle Nord, où la Créature poursuit Victor Frankenstein. Par le biais de flashbacks, Victor raconte son histoire au capitaine du navire : une enfance malheureuse marquée par un père violent et glaçant (incarné par Charles Dance), l’arrivée de Harlander (Christoph Waltz, toujours impeccable) qui finance ses travaux, et sa relation avec Elizabeth (Mia Goth, merveilleuse), fiancée à William (Felix Kammerer), le petit frère de Victor.
Des performances au sommet
Oscar Isaac livre une interprétation parfaite du tourmenté Victor Frankenstein, tandis que Jacob Elordi éblouit dans le rôle de la Créature, un personnage initialement destiné à Andrew Garfield. Les deux acteurs sont au sommet de leur art, offrant des performances qui portent toute la charge émotionnelle du film.
Mia Goth confirme une fois de plus son talent, apportant une touche de lumière dans cet univers sombre, tandis que Charles Dance glace le sang en père tyrannique et Christoph Waltz incarne avec sa justesse habituelle le mystérieux bienfaiteur Harlander.
Humanité et inhumanité
Le film développe des thèmes chers au cinéaste, déjà explorés dans La forme de l’eau (Oscar du meilleur film) : qu’est-ce qui constitue l’humanité… et donc l’inhumanité ? Cette opposition constante entre les deux concepts traverse tout le récit.
Del Toro n’hésite pas à montrer la violence crue : le découpage des cadavres, l’assemblage minutieux de la Créature, les torrents de sang qui s’échappent du laboratoire. Cette cruauté visuelle souligne la dureté implacable de tous les personnages masculins et sert d’allégorie sur l’arrogance des hommes, les violences et l’obsession qui les animent.
Une sortie sur Netflix
Les spectateurs pourront découvrir cette vision personnelle de Frankenstein sur Netflix à partir du 7 novembre.
Pour Guillermo del Toro, ce Frankenstein représente bien plus qu’une simple adaptation. C’est un testament artistique, un cri du cœur en faveur de l’art authentique et de l’émotion humaine dans un monde de plus en plus dominé par l’artificiel. Un message qui, comme la créature de Mary Shelley, continue de nous interroger sur ce qui fait de nous des êtres humains.
Écrit par: Loic Couatarmanach
Articles similaires
En direct
A venir

CTRL+Play
Patchwork sonore entre nouveautés et classiques, où la touche pause n’existe plus.
17:00 - 19:00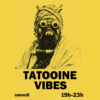
Tatooine Vibes
Petit détour par une galaxie lointaine avant l’appel de la House.
19:00 - 23:00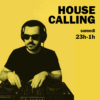
House Calling
Animé par DJ Jack
23:00 - 23:59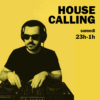
House Calling
Animé par DJ Jack
00:00 - 01:00
Ça Plane pour Moi
Légèreté mélomane pour surfer toute la nuit.
01:00 - 05:00
Copyright 2026 Cadence inc

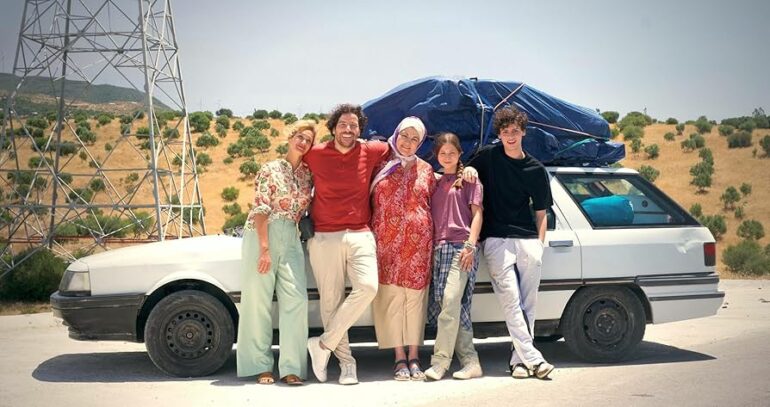

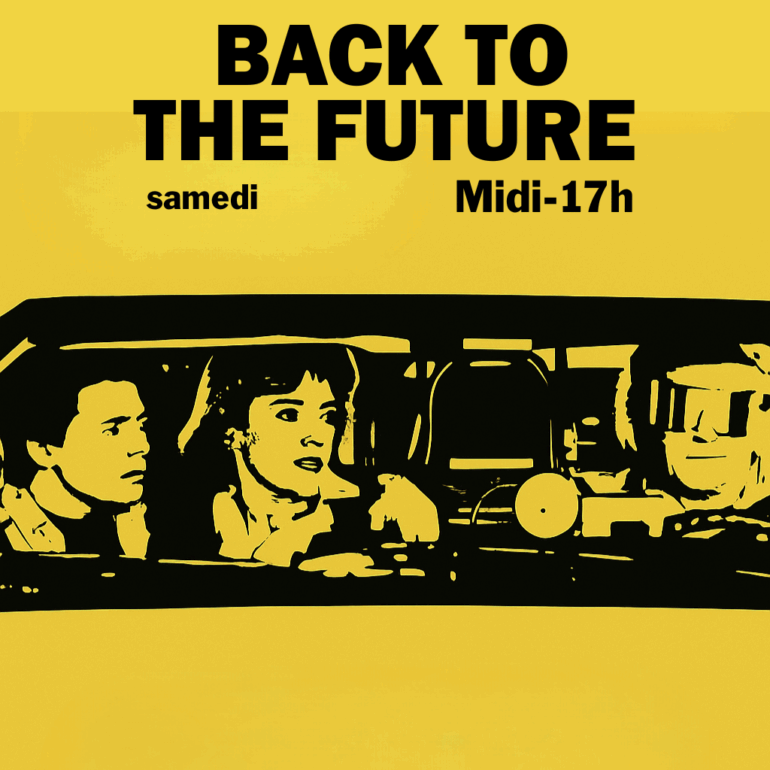
Commentaires d’articles (0)